Les « vaches de Staline », c’est ainsi que les Estoniens déportés en Sibérie désignèrent les maigres chèvres qu’ils trouvèrent là-bas. C’est aussi le titre du premier roman de Sofi Oksanen, dont l’héroïne, Anna, est une jeune finlandaise née dans les années 1970, qui souffre de troubles alimentaires profonds. La mère de celle-ci est estonienne, et afin d’être acceptée de l’autre côté du « Mur », elle a tenté d’effacer toute trace de ses origines et de taire les traumatismes de l’ère soviétique.
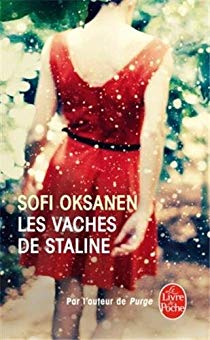
Il y a quelques temps, j’ai découvert Sofi Oksanen avec Purge, dont on avait beaucoup parlé lors de sa sortie en France. J’en gardais un très bon souvenir (même si à relire ma critique, il semblerait que le style ne m’ait guère convaincue… l’histoire en tout cas valait le détour). J’avais donc acheté ensuite Les vaches de Staline, le premier roman de l’auteur. Il a bien longtemps dormi sur mes étagères avant que je me décide à l’en déloger. Il a même figuré durant plusieurs années sur ma liste de lecture de l’année, mais ça y est, c’est à présent chose faite !
Le roman alterne entre deux récits (voire 3 sur le dernier tiers) : celui d’une jeune femme estonienne qui quitte son pays pour épouser un finlandais, et celui de sa fille des années plus tard, anorexique et boulimique. Vient se mêler par moment l’histoire de la génération précédente, lors de la guerre en Estonie. Des récits forts et parfois difficiles qui se lisent à petite dose et demandent parfois un peu de temps pour être digérés. L’histoire de la mère est avant tout celle de la nostalgie de son pays, du choc des cultures en passant à l’Ouest et des désillusions qui ont émaillé son parcours, d’un côté comme de l’autre de la frontière.
Mais le récit que j’ai trouvé le plus réussi reste celui de la jeune fille. Sans jamais tomber dans le pathos, l’auteur parvient à nous faire partager un peu de son quotidien, et surtout de son ressenti. C’est souvent dur, pesant, mais aussi assez touchant. Ca permet sans doute d’appréhender un peu mieux ce type de troubles. Le roman est un peu long parfois et a tendance à tourner en rond sur la fin mais j’ai trouvé que sa grande force venait de cette capacité à nous faire entrevoir le quotidien de cette jeune femme. Un premier roman qui manque un peu de rythme mais traite un sujet fort avec un certain talent. On en ressort chamboulé.

Je n’ai plus de souffle. Il faut que je .arrête de parler Que je réduise mon corps au silence, que je l’aplatisse par terre comme sous une tapette à mouche. Il ne demande plus beaucoup. Encore un peu… Juste un peu. Si peu.
_______________
Le socialisme ne réussirait jamais ailleurs que sur le papier pour la simple raison que les doigts de tout le monde ne se tendent que vers soi, vers l’intérieur, même quand la main s’avance pour donner.












 Fut un temps où je lisais beaucoup de classiques russes (enfin beaucoup… plus que la moyenne en tout cas). Je me suis délectée de l’univers sombre de Dostoïevski, je me suis agacée des digressions de Tolstoï, j’ai admiré la plume de Gorki et j’ai baillé en découvrant Premier amour de Tourgueniev. Je n’avais rien lu d’autre de lui et la nouvelle traduction de 3 de ses nouvelles était l’occasion de connaître un peu mieux cet auteur. Dans ces 3 textes, il met à la sauce russe des classiques de la littérature européenne – dont le Roi Lear. Prometteur. Bon, soyons francs, je me suis ennuyée ferme. J’ai rarement connu style aussi soporifique. Que ça peut être guindé ! Autre problème, je maîtrise assez mal les textes de départ, lus il y a longtemps, j’ai donc probablement raté pas mal des subtilités de ces textes qui intellectualisent beaucoup, beaucoup leurs références. J’ai essayé de les apprécier simplement comme de bonnes histoires mais à vrai dire elles n’ont pas grand intérêt en temps que telles et m’ont plutôt fait penser à un exercice de style, une branlette intellectuelle d’un autre temps. J’ai bien peut qu’entre Tourgueniev et moi le courant ne passe définitivement pas.
Fut un temps où je lisais beaucoup de classiques russes (enfin beaucoup… plus que la moyenne en tout cas). Je me suis délectée de l’univers sombre de Dostoïevski, je me suis agacée des digressions de Tolstoï, j’ai admiré la plume de Gorki et j’ai baillé en découvrant Premier amour de Tourgueniev. Je n’avais rien lu d’autre de lui et la nouvelle traduction de 3 de ses nouvelles était l’occasion de connaître un peu mieux cet auteur. Dans ces 3 textes, il met à la sauce russe des classiques de la littérature européenne – dont le Roi Lear. Prometteur. Bon, soyons francs, je me suis ennuyée ferme. J’ai rarement connu style aussi soporifique. Que ça peut être guindé ! Autre problème, je maîtrise assez mal les textes de départ, lus il y a longtemps, j’ai donc probablement raté pas mal des subtilités de ces textes qui intellectualisent beaucoup, beaucoup leurs références. J’ai essayé de les apprécier simplement comme de bonnes histoires mais à vrai dire elles n’ont pas grand intérêt en temps que telles et m’ont plutôt fait penser à un exercice de style, une branlette intellectuelle d’un autre temps. J’ai bien peut qu’entre Tourgueniev et moi le courant ne passe définitivement pas. Voici un recueil qui m’a déroutée. Je suis une grande admiratrice de Jack London. J’ai lu beaucoup de ses textes (mais pas tous, loin s’en faut !) et je pense pouvoir affirmer relativement bien connaître son œuvre. J’ai un gros faible pour ses récits d’aventure même si ses romans sont bien loin de se résumer à ça. Je m’attendais à retrouver dans ces trois textes la force de « L’amour de la vie » notamment, qui est quelque chose comme ma nouvelle préférée de tous les temps (plus ou moins). Eh bien pas du tout ! J’ai été très surprise par la première nouvelle, très politique et qui expose des thèses proches de l’anarchisme. La seconde nouvelle nous transporte dans le Grand Nord et porte bien un esprit d’aventure avec un homme prêt à tout pour échapper à la torture. Enfin, la dernière se rapproche presque du conte, avec l’histoire d’une perle rare sur un atoll que la tempête menace. Trois texte très différents rassemblés pour Borges pour démontrer toute l’étendue du talent de Jack London. Et c’est plutôt réussi ! Si ce ne sont pas mes textes préférés de l’auteur, ils mettent en avant différents aspects de son œuvre avec un certain brio.
Voici un recueil qui m’a déroutée. Je suis une grande admiratrice de Jack London. J’ai lu beaucoup de ses textes (mais pas tous, loin s’en faut !) et je pense pouvoir affirmer relativement bien connaître son œuvre. J’ai un gros faible pour ses récits d’aventure même si ses romans sont bien loin de se résumer à ça. Je m’attendais à retrouver dans ces trois textes la force de « L’amour de la vie » notamment, qui est quelque chose comme ma nouvelle préférée de tous les temps (plus ou moins). Eh bien pas du tout ! J’ai été très surprise par la première nouvelle, très politique et qui expose des thèses proches de l’anarchisme. La seconde nouvelle nous transporte dans le Grand Nord et porte bien un esprit d’aventure avec un homme prêt à tout pour échapper à la torture. Enfin, la dernière se rapproche presque du conte, avec l’histoire d’une perle rare sur un atoll que la tempête menace. Trois texte très différents rassemblés pour Borges pour démontrer toute l’étendue du talent de Jack London. Et c’est plutôt réussi ! Si ce ne sont pas mes textes préférés de l’auteur, ils mettent en avant différents aspects de son œuvre avec un certain brio. Autre déception avec ces contes. Je connais mal Margaret Atwood (pour ne pas dire « pas »). Je n’ai lu d’elle que son dernier roman, que j’avais beaucoup aimé, et j’ai vu l’adaptation en série de « La servante écarlate » que j’ai absolument adorée. Je partais donc avec un a priori très positif et l’envie de mieux découvrir son œuvre. Je n’ai pas du tout retrouvé dans ces courts textes la force de ses romans. J’ai trouvé ça somme toute assez « mignon » et je n’ai pas bien compris où elle voulait amener le lecteur. J’ai bien aimé que les 3 premiers contes soient liés, même si ça reste assez anecdotiques. Les deux suivants m’ont laissée encore plus perplexe. Je ne suis finalement pas allée au bout. Je n’ai pas vraiment accroché avec cet univers qui pour moi manquait de profondeur, je m’attendais à des textes plus fort mais ça reste dans l’ensemble assez anecdotique. J’ai l’impression d’être totalement passée à côté.
Autre déception avec ces contes. Je connais mal Margaret Atwood (pour ne pas dire « pas »). Je n’ai lu d’elle que son dernier roman, que j’avais beaucoup aimé, et j’ai vu l’adaptation en série de « La servante écarlate » que j’ai absolument adorée. Je partais donc avec un a priori très positif et l’envie de mieux découvrir son œuvre. Je n’ai pas du tout retrouvé dans ces courts textes la force de ses romans. J’ai trouvé ça somme toute assez « mignon » et je n’ai pas bien compris où elle voulait amener le lecteur. J’ai bien aimé que les 3 premiers contes soient liés, même si ça reste assez anecdotiques. Les deux suivants m’ont laissée encore plus perplexe. Je ne suis finalement pas allée au bout. Je n’ai pas vraiment accroché avec cet univers qui pour moi manquait de profondeur, je m’attendais à des textes plus fort mais ça reste dans l’ensemble assez anecdotique. J’ai l’impression d’être totalement passée à côté.


