M comme Mabel, d’Helen Macdonald
Enfant, Helen rêvait d’être fauconnier. Devenue adulte, elle va avoir l’occasion de le réaliser. De manière brutale son père s’effondre un matin dans la rue. Terrassée par le chagrin, passant par toutes les phases du deuil, Helen va entreprendre un long voyage physique et métaphysique.
 Je suis assez fascinée par la fauconnerie même si je n’y connais absolument rien et que je n’ai jamais eu l’occasion de m’y intéresser. Quand j’ai lu la 4° de couverture de ce roman, je me suis dit que ça pourrait me plaire et changer un peu des sujets abordés habituellement. Au début, j’ai vraiment cru que ça allait me plaire. Le style est travaillé et assez agréable et la construction du roman semblait plutôt intéressante. Pourtant, j’ai très vite décroché ! Il y a de très longs passages entièrement axés sur la fauconnerie (je sais, c’est un peu le sujet du livre…) et bien qu’ils ne soient pas particulièrement techniques, je n’ai pas du tout réussi à rentrer dedans et à partager un tant soit peu les émotions du personnage. J’ai trouvé ça très froid et assez dénué de sensibilité. Il y a un côté un peu guindé qui m’a bloquée. J’ai eu beau essayer de m’intéresser à cette histoire, je n’ai pas pris le moindre plaisir à cette lecture, alors même que j’ai trouvé le style assez beau. J’ai fini par abandonner avant de me lasser davantage. On sent l’auteur passionnée par son sujet et bien que j’aie eu envie de découvrir cet univers, je n’ai malheureusement pas réussi à rentrer dedans. Dommage.
Je suis assez fascinée par la fauconnerie même si je n’y connais absolument rien et que je n’ai jamais eu l’occasion de m’y intéresser. Quand j’ai lu la 4° de couverture de ce roman, je me suis dit que ça pourrait me plaire et changer un peu des sujets abordés habituellement. Au début, j’ai vraiment cru que ça allait me plaire. Le style est travaillé et assez agréable et la construction du roman semblait plutôt intéressante. Pourtant, j’ai très vite décroché ! Il y a de très longs passages entièrement axés sur la fauconnerie (je sais, c’est un peu le sujet du livre…) et bien qu’ils ne soient pas particulièrement techniques, je n’ai pas du tout réussi à rentrer dedans et à partager un tant soit peu les émotions du personnage. J’ai trouvé ça très froid et assez dénué de sensibilité. Il y a un côté un peu guindé qui m’a bloquée. J’ai eu beau essayer de m’intéresser à cette histoire, je n’ai pas pris le moindre plaisir à cette lecture, alors même que j’ai trouvé le style assez beau. J’ai fini par abandonner avant de me lasser davantage. On sent l’auteur passionnée par son sujet et bien que j’aie eu envie de découvrir cet univers, je n’ai malheureusement pas réussi à rentrer dedans. Dommage.
Il existe un mot pour dire le deuil, en anglais. Bereavement. Ou encore bereaved ou bereft, « endeuillé ». Du vieil anglais bereafian, qui signifie « priver de », « ôter », « saisir », « dérober ». Dérobé.Saisi. Cela arrive à tout le monde, mais on le ressent seul.
Yaak Valley, Montana, de Smith Henderson
Dans le Montana, en 1980, autour de Pete, assistant social dévoué, gravite tout un monde d’écorchés vifs et d’âmes déséquilibrées. Il y a Beth, son ex infidèle et alcoolique, Rachel, leur fille de treize ans, en fugue, Luke, son frère recherché par la police, Cecil l’adolescent violent et sa mère droguée et hystérique, et ce jeune Benjamin, qui vit dans les bois environnants, avec son père, Jeremiah, un illuminé persuadé que l’apocalypse est proche.
 Je le découvre uniquement à présent mais ce livre est un premier roman et aurait donc eu bien plus sa place dans mon article qui leur était consacré (surtout que c’est un des premiers livres de cette rentrée que j’ai lus…). Le mal est fait et, après avoir hésité à le mettre parmi les polars, le voilà finalement en littérature étrangère. J’ai bien aimé l’univers très sombre de ce livre. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un polar mais il emprunte parfois au thriller. Ce roman m’a clairement fait penser aux classiques du nature writing et aurait pu entrer dans la collection noire de Gallmeister. Ca tombe bien, c’est un genre que j’adore et que je lis bien trop peu. J’ai beaucoup aimé la manière dont les personnages sont construits. Chacun a ses faiblesses et tous semblent constamment au bord du gouffre, créant une certaine tension dans ce récit dont l’anti-héros est attachant. Un livre qui explore les marges de la société avec beaucoup de justesse et une certaine sensibilité sous des abords plutôt rudes. Il met en avant les contradictions d’un pays qui ignore ceux qui sortent de la norme et m’a donné envie d’en découvrir les aspects cachés autant que les paysages. Un style sobre, un univers assez noir et la découverte d’une Amérique déshéritée. Un très beau roman.
Je le découvre uniquement à présent mais ce livre est un premier roman et aurait donc eu bien plus sa place dans mon article qui leur était consacré (surtout que c’est un des premiers livres de cette rentrée que j’ai lus…). Le mal est fait et, après avoir hésité à le mettre parmi les polars, le voilà finalement en littérature étrangère. J’ai bien aimé l’univers très sombre de ce livre. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un polar mais il emprunte parfois au thriller. Ce roman m’a clairement fait penser aux classiques du nature writing et aurait pu entrer dans la collection noire de Gallmeister. Ca tombe bien, c’est un genre que j’adore et que je lis bien trop peu. J’ai beaucoup aimé la manière dont les personnages sont construits. Chacun a ses faiblesses et tous semblent constamment au bord du gouffre, créant une certaine tension dans ce récit dont l’anti-héros est attachant. Un livre qui explore les marges de la société avec beaucoup de justesse et une certaine sensibilité sous des abords plutôt rudes. Il met en avant les contradictions d’un pays qui ignore ceux qui sortent de la norme et m’a donné envie d’en découvrir les aspects cachés autant que les paysages. Un style sobre, un univers assez noir et la découverte d’une Amérique déshéritée. Un très beau roman.
Beaucoup de gens viennent ici pour fuir quelque chose. Mais la plupart d’entre nous traînent de sacrées casseroles en plus de leurs valises.
Les règles d’usages, de Joyce Maynard
Wendy, treize ans, vit à Brooklyn. Le 11 septembre 2001, son monde est complètement chamboulé : sa mère part travailler et ne revient pas. L’espoir s’amenuise jour après jour et, à mesure que les affichettes DISPARUE se décollent, fait place à la sidération.
 J’ai découvert Joyce Maynard il y a deux ans avec L’homme de la montagne, que j’avais beaucoup aimé. Je ne sais pas trop pourquoi, j’avais dans l’idée que c’était une sorte de polar alors que pas du tout. J’avais totalement oublié la 4° de couverture et c’est tant mieux, j’ai ainsi eu la joie de la découverte, même si le sujet n’est pas exactement facile. Joyce Maynard y traite avec beaucoup de délicatesse le deuil et l’adolescence. Moi qui ne suis pas très friandes de ces sujets, j’ai trouvé que ce roman était d’une grande justesse. Autant que le processus de deuil, la peinture qu’elle fait de l’adolescence est touchante. La manière dont l’auteur dépeint la journée du 11 septembre est saisissante et j’en ai sans doute plus encore ressenti l’horreur en lisant ce roman que le jour des faits, où j’étais sans doute un peu jeune pour en saisir l’ampleur. On s’attache peu à peu aux personnages qui sont très soignées, avec des personnalités rendus intéressantes par nombre de petits défauts. Le style est toujours aussi convaincant et l’auteur parvient à mettre une certaine tension en place, alors qu’on s’y attendrait cette fois un peu moins. Le rythme de ce roman est assez lent, pourtant on a envie de connaître la suite et je dois avouer que ma lecture a eu un côté assez frénétique. J’ai vraiment adoré ce livre qui pour moi est un des grands romans de cette rentrée littéraire. Extrêmement touchant.
J’ai découvert Joyce Maynard il y a deux ans avec L’homme de la montagne, que j’avais beaucoup aimé. Je ne sais pas trop pourquoi, j’avais dans l’idée que c’était une sorte de polar alors que pas du tout. J’avais totalement oublié la 4° de couverture et c’est tant mieux, j’ai ainsi eu la joie de la découverte, même si le sujet n’est pas exactement facile. Joyce Maynard y traite avec beaucoup de délicatesse le deuil et l’adolescence. Moi qui ne suis pas très friandes de ces sujets, j’ai trouvé que ce roman était d’une grande justesse. Autant que le processus de deuil, la peinture qu’elle fait de l’adolescence est touchante. La manière dont l’auteur dépeint la journée du 11 septembre est saisissante et j’en ai sans doute plus encore ressenti l’horreur en lisant ce roman que le jour des faits, où j’étais sans doute un peu jeune pour en saisir l’ampleur. On s’attache peu à peu aux personnages qui sont très soignées, avec des personnalités rendus intéressantes par nombre de petits défauts. Le style est toujours aussi convaincant et l’auteur parvient à mettre une certaine tension en place, alors qu’on s’y attendrait cette fois un peu moins. Le rythme de ce roman est assez lent, pourtant on a envie de connaître la suite et je dois avouer que ma lecture a eu un côté assez frénétique. J’ai vraiment adoré ce livre qui pour moi est un des grands romans de cette rentrée littéraire. Extrêmement touchant.
On continue à se lever chaque matin en sachant que ça durera peut-être dix mille matins de plus. On préférerait être celui qui est mort. En quoi ce serait mieux ?
Les vies de papier, de Rabih Alameddine
Aaliya Saleh, 72 ans, est inclassable. Mariée à 16 ans à « un insecte impuissant », elle a été répudiée au bout de quatre ans. Pas de mari, pas d’enfant, pas de religion… Non conventionnelle et un brin obsessionnelle, elle a toujours lutté à sa manière contre le carcan imposé par la société libanaise. Une seule passion l’anime: la littérature.
 Le résumé de ce livre me laissait un peu perplexe, je me suis toutefois laissée tenter parce que comme vous devez le savoir à présent, dès qu’il est question d’un roman sur livres, librairies ou bibliothèques, je finis toujours par céder à la tentation. Que voulez-vous, faible je suis. Au début, j’ai été assez agréablement surprise. Le personnage me semblait plutôt sympathique, j’accrochais bien avec le style, tout allait bien. Et puis je me suis lassée. Vite même. Ce roman se lit très bien, c’est plutôt bien écrit, facile à lire mais pas insipide ; de ce côté-là tout va bien. En revanche, les souvenirs de vieille dame bon… Pourtant à Beyrouth il y a de quoi faire ! Mais là ça part dans tous les sens. Etant casanière, elle n’a finalement pas grand chose à raconter et survole tout les sujets, passant de l’un à l’autre avec une inconstance qui devient lassante. Quant à son amour pour les livres, je m’y suis moins retrouvée que j’aurais cru et j’ai parfois trouvé la débauche de citations un peu lourde (même si je dois admettre qu’elles sont relativement bien intégrées et qu’il y a bien pire dans le genre). Il n’y a qu’à la toute fin que j’ai connu un vague regain d’intérêt mais il était un peu tard. Malgré certaines qualités, un roman qui ne m’a pas trop convaincue, voire même ennuyée.
Le résumé de ce livre me laissait un peu perplexe, je me suis toutefois laissée tenter parce que comme vous devez le savoir à présent, dès qu’il est question d’un roman sur livres, librairies ou bibliothèques, je finis toujours par céder à la tentation. Que voulez-vous, faible je suis. Au début, j’ai été assez agréablement surprise. Le personnage me semblait plutôt sympathique, j’accrochais bien avec le style, tout allait bien. Et puis je me suis lassée. Vite même. Ce roman se lit très bien, c’est plutôt bien écrit, facile à lire mais pas insipide ; de ce côté-là tout va bien. En revanche, les souvenirs de vieille dame bon… Pourtant à Beyrouth il y a de quoi faire ! Mais là ça part dans tous les sens. Etant casanière, elle n’a finalement pas grand chose à raconter et survole tout les sujets, passant de l’un à l’autre avec une inconstance qui devient lassante. Quant à son amour pour les livres, je m’y suis moins retrouvée que j’aurais cru et j’ai parfois trouvé la débauche de citations un peu lourde (même si je dois admettre qu’elles sont relativement bien intégrées et qu’il y a bien pire dans le genre). Il n’y a qu’à la toute fin que j’ai connu un vague regain d’intérêt mais il était un peu tard. Malgré certaines qualités, un roman qui ne m’a pas trop convaincue, voire même ennuyée.
Nulle perte n’est ressentie avec autant d’acuité que celle de ce qui aurait pu être. Nulle nostalgie fait autant souffrir que la nostalgie des choses qui n’ont jamais existé.
Watership Down, de Richard Adams
Menés par le valeureux Hazel et le surprenant Fyveer, une poignée de braves lapins choisit de fuir l’inéluctable destruction de leur foyer. Prémonitions, malices et légendes vont guider ces héros face aux mille ennemis qui les guettent, et leur permettront peut-être de franchir les épreuves qui les séparent de leur terre promise, Watership Down. Mais l’aventure s’arrêtera-t-elle vraiment là ?
 Bien qu’il se soit vendu à une flopée d’exemplaires, je n’avais jamais entendu parler de ce roman, ni de son auteur. J’ai eu un peu peur en voyant le pavé que c’était. Sans doute en raison de la couverture, je m’attendais à quelque chose d’assez sombre et j’ai été déroutée de me retrouver face à des petits lapins dans leur garenne… J’ai failli abandonner, 550 p de petits sauts et de pissenlits me semblaient de trop. Et puis, j’ai continué ma lecture et, passé l’effet de surprise, je me suis totalement laissée embarquer dans les aventures de nos amis rongeurs. Impossible de quitter ce livre une fois qu’on l’a entamé ! Qui eut cru que les histoires de garennes puissent être aussi palpitantes ? Je me suis prise d’affection pour la troupe de lapinous et j’ai tremblé à chacune de leurs embûches et de leurs rencontres avec des vilous (les prédateurs en tous genres). L’auteur parvient à créer un univers assez décalé et très attachant. Ses lapins sont empreints d’une philosophie de vie insoupçonnée qui ne laisse pas indifférent. L’écriture est fluide et quelques touches d’humour complètent le tableau. J’ai finalement pris goût à cette aventure que j’ai lu quasiment d’une traite. Un roman fleuve palpitant et terriblement mignon.
Bien qu’il se soit vendu à une flopée d’exemplaires, je n’avais jamais entendu parler de ce roman, ni de son auteur. J’ai eu un peu peur en voyant le pavé que c’était. Sans doute en raison de la couverture, je m’attendais à quelque chose d’assez sombre et j’ai été déroutée de me retrouver face à des petits lapins dans leur garenne… J’ai failli abandonner, 550 p de petits sauts et de pissenlits me semblaient de trop. Et puis, j’ai continué ma lecture et, passé l’effet de surprise, je me suis totalement laissée embarquer dans les aventures de nos amis rongeurs. Impossible de quitter ce livre une fois qu’on l’a entamé ! Qui eut cru que les histoires de garennes puissent être aussi palpitantes ? Je me suis prise d’affection pour la troupe de lapinous et j’ai tremblé à chacune de leurs embûches et de leurs rencontres avec des vilous (les prédateurs en tous genres). L’auteur parvient à créer un univers assez décalé et très attachant. Ses lapins sont empreints d’une philosophie de vie insoupçonnée qui ne laisse pas indifférent. L’écriture est fluide et quelques touches d’humour complètent le tableau. J’ai finalement pris goût à cette aventure que j’ai lu quasiment d’une traite. Un roman fleuve palpitant et terriblement mignon.
Les créatures qui n’ont ni livre ni horloge sont aussi sensibles aux secrets du temps qui passe qu’à ceux du temps qu’il fait ; elles savent également s’orienter, comme en témoignent leurs extraordinaires migrations.
1816, l’année sans été, de Gillen d’Arcy Wood
En avril 1815, près de Java, l’éruption cataclysmique du volcan Tambora a projeté dans la stratosphère un voile de poussière qui va filtrer le rayonnement solaire plusieurs années durant. Ignoré des livres d’histoire, ce bouleversement climatique fait des millions de morts. On lui doit aussi de profondes mutations culturelles.
 J’aimais beaucoup la couverture de ce livre et son titre assez intriguant, j’ai donc décidé de me lancer. Pour d’obscures raisons, j’étais persuadée qu’il s’agissait d’un roman (le titre encore je crois, je n’avais pas dû lire le sous-titre…), quelle ne fut donc pas ma surprise en constatant que c’était en réalité un essai sur le rapport entre climatologie et climat qui expose en particulier les conséquences désastreuses de l’impact de l’éruption du Tambora en 1815. La bonne nouvelle, c’est que c’est très intéressant. La mauvaise c’est que quand on veut lire un roman, on se retrouve quand même avec quelque chose d’un peu plus ardu que prévu… L’auteur parvient assez bien à vulgariser son propos pour qu’il soit compréhensible par tous. Les schémas et graphiques peuvent aider à mieux visualiser les concepts évoqués. Il y a vraiment un gros effort de fait pour rendre le texte accessible, ce que j’ai beaucoup apprécié. De nombreux domaines sont évoqués : vulcanologie et climatologie bien sûr mais aussi sociologie ou culture avec les impacts à long terme et l’influence de cet événement sur l’art que j’ai trouvé très intéressant. J’aurais en revanche aimé des chapitres organisés différemment. On passe d’une chose à l’autre sans vraiment approfondir, pour y revenir plus tard, ce qui l’a un peu gênée. Un essai intéressant et assez facile à appréhender mais que j’ai parfois eu du mal à suivre par son côté un peu dispersé. Intéressant tout de même.
J’aimais beaucoup la couverture de ce livre et son titre assez intriguant, j’ai donc décidé de me lancer. Pour d’obscures raisons, j’étais persuadée qu’il s’agissait d’un roman (le titre encore je crois, je n’avais pas dû lire le sous-titre…), quelle ne fut donc pas ma surprise en constatant que c’était en réalité un essai sur le rapport entre climatologie et climat qui expose en particulier les conséquences désastreuses de l’impact de l’éruption du Tambora en 1815. La bonne nouvelle, c’est que c’est très intéressant. La mauvaise c’est que quand on veut lire un roman, on se retrouve quand même avec quelque chose d’un peu plus ardu que prévu… L’auteur parvient assez bien à vulgariser son propos pour qu’il soit compréhensible par tous. Les schémas et graphiques peuvent aider à mieux visualiser les concepts évoqués. Il y a vraiment un gros effort de fait pour rendre le texte accessible, ce que j’ai beaucoup apprécié. De nombreux domaines sont évoqués : vulcanologie et climatologie bien sûr mais aussi sociologie ou culture avec les impacts à long terme et l’influence de cet événement sur l’art que j’ai trouvé très intéressant. J’aurais en revanche aimé des chapitres organisés différemment. On passe d’une chose à l’autre sans vraiment approfondir, pour y revenir plus tard, ce qui l’a un peu gênée. Un essai intéressant et assez facile à appréhender mais que j’ai parfois eu du mal à suivre par son côté un peu dispersé. Intéressant tout de même.
Un bouleversement climatique catastrophique a provoqué un changement dans les idées à l’échelle du monde autant qu’un traumatisme global.
La vengeance des mères, de Jim Fergus
Margaret et Susan Kelly, traumatisées par la perte de leurs enfants et par le comportement sanguinaire de l’armée, refusent de rejoindre la « civilisation ». Après avoir trouvé refuge dans la tribu de Sitting Bull, elles vont prendre le parti du peuple indien et se lancer, avec quelques prisonnières des Sioux, dans une lutte désespérée pour leur survie.
 J’avais a-do-ré Mille femmes blanches, énorme coup de cœur il y a quelques temps déjà. Quand j’ai su qu’une suite allait sortir 15 ans après le premier roman, je ne tenais plus en place, trop heureuse de retrouver l’immensité des plaines et la culture cheyenne. Je me demandais comment l’auteur allait s’en sortir avec cette suite étant donnée que la fin du premier roman sonnait comme plutôt définitive (pour ne pas trop en révéler). Finalement, il gère ça on ne peut mieux ! L’intrigue se situe quelques mois après la fin des événements précédents mais l’ambiance reste la même. Le style quant à lui change un peu et s’avère plus fluide. J’ai pris un énorme plaisir à replonger dans les cultures indiennes, si riches et intéressantes, mais aussi dans leur histoire. Bien sûr, je ne vous apprendrai rien en vous disant que le récit est plutôt tragique. Pourtant, il est aussi plein d’espoir et d’humanité. J’ai lu ce livre à une vitesse folle et ne l’ai refermé qu’à grand regret, tant je me suis attachée à cet univers et les personnages qui le peuplent. J’espère que le troisième (et dernier tome) ne se fera pas trop attendre. Une roman d’une grande richesse qui nous emporte dans un monde si différent du notre et donne envie de s’intéresser de bien plus près aux cultures amérindiennes. Tout simplement magnifique.
J’avais a-do-ré Mille femmes blanches, énorme coup de cœur il y a quelques temps déjà. Quand j’ai su qu’une suite allait sortir 15 ans après le premier roman, je ne tenais plus en place, trop heureuse de retrouver l’immensité des plaines et la culture cheyenne. Je me demandais comment l’auteur allait s’en sortir avec cette suite étant donnée que la fin du premier roman sonnait comme plutôt définitive (pour ne pas trop en révéler). Finalement, il gère ça on ne peut mieux ! L’intrigue se situe quelques mois après la fin des événements précédents mais l’ambiance reste la même. Le style quant à lui change un peu et s’avère plus fluide. J’ai pris un énorme plaisir à replonger dans les cultures indiennes, si riches et intéressantes, mais aussi dans leur histoire. Bien sûr, je ne vous apprendrai rien en vous disant que le récit est plutôt tragique. Pourtant, il est aussi plein d’espoir et d’humanité. J’ai lu ce livre à une vitesse folle et ne l’ai refermé qu’à grand regret, tant je me suis attachée à cet univers et les personnages qui le peuplent. J’espère que le troisième (et dernier tome) ne se fera pas trop attendre. Une roman d’une grande richesse qui nous emporte dans un monde si différent du notre et donne envie de s’intéresser de bien plus près aux cultures amérindiennes. Tout simplement magnifique.
Certaines blessures, profondes et durables, ne se referment pas, ne guérissent pas. Les paroles, la compassion ne peuvent apporter de réconfort, car ces plaies-là restent constamment à vif.
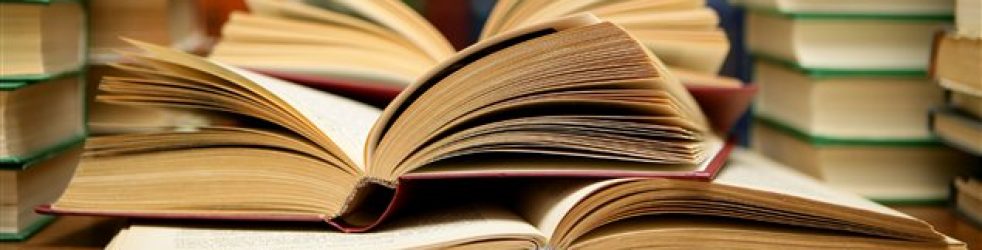
Je suis bien d’accord sur « Les règles d’usage » !
Un de mes gros coups de coeur de la rentrée !