Comme promis, voici une première page thématique. Pour la première, je ne vais pas faire dans l’originalité mais reprendre le thème qui a marqué mon année 2011 : la littérature et le sida. Je sais, on va encore me dire que c’est déprimant mais pas du tout ! La littérature sur le sida est étonnamment optimiste. L’occasion de revenir un peu sur les livres qui ont marqué mon année et de clôturer ainsi ce travail.

La littérature sur le sida est née au début des années 90, au moment où la maladie s’est transformée en véritable pandémie et a décimé le milieu homosexuel. C’est aussi à cette époque que des chercheurs français identifient le virus, lui donnent un nom, et que les premiers traitements font leur apparition. Cette maladie, dont on sait alors très peu de choses, crée un véritable vent de panique et est à la naissance d’une forte création artistique. La littérature a voulu dire cette impuissance face à un fléau méconnu. Hervé Guibert fut un des premiers à oser avouer qu’il en était atteint et a placé la maladie au centre de son oeuvre. À l’ami qui ne pas sauvé la vie retrace l’annonce de la maladie et décrit aussi bien les symptômes physiques que la douleur psychologique. Étrangement, il apparaît que si la maladie et la mort certaine qu’elle entraîne fait bien sûr peur, elle est aussi accueillie comme une incitation à profiter d’autant plus du temps qu’il reste pour parachever son oeuvre. Une idée qu’on retrouvera chez bien d’autres artistes. Le protocole compassionnel est la suite du premier et se centre plus sur le traitement, les espoirs, la vie avec la maladie. Deux livres forts, non dénués d’humour, où la maladie apparaît avant tout comme le meilleur des sujets.

Autre très beau livre, Ce sont amis que vent emporte d’Yves Navarre. Ici la maladie est presque secondaire, elle s’efface devant une fabuleuse histoire d’amour entre deux hommes en phase terminale du sida. Un texte très émouvant et totalement dénué du pathos qu’on pourrait attendre dans ce type de sujet. Un livre que je classe sans hésiter parmi les beaux qu’il m’ait été donné de lire. Plus surprenant encore, un livre drôle. Oui oui, un livre sur le sida qui nous fait rire (jaune, certes, mais tout de même !). Air conditionné est un roman contemporain qui se passe dans la milieu de l’édition. Un homme vient de perdre son compagnon du sida et veut lutter contre l’exclusion qu’il a vécu. Une dénonciation à la fois de la manière dont la société traite ses malades mais aussi et surtout du terrible milieu de l’édition. Le cynisme dont fait preuve l’auteur m’a ravie.

Inclassable, Alexandre Bergamini avec Sang damné. Un livre d’une grande complexité et d’une rare maîtrise. L’auteur mêle autobiographie, poésie, extraits d’articles ou de procès verbaux. C’est extrêmement bien écrit, on se laisse totalement porter par la force de cette écriture. Un texte très personnel et pour le moins original. On retrouve une fascination pour la maladie qu’on pouvait déjà voir chez Hervé Guibert. Un texte déroutant qui met à mal bien des préjugés. Il permet également d’informer sur l’avancée des traitement et la vie d’un séropositif aujourd’hui. Une dédramatisation qui peut surprendre. Un texte un peu difficile sans doute mais qui mérite le détour, pour un livre qui peut se comparer aux plus grands.

Voilà pour mes coups de coeur. Il y a d’autres livres qui m’ont moins convaincue. Parmi eux Les quartiers d’hiver de Jean-Noël Pancrazi, qui a reçu le prix Médicis. Ecrit au début des années 90, il retrace l’histoire d’un homme dont les amis meurent les uns après les autres du sida. Un texte tout en retenu que j’ai trouvé un peu ampoulé. Dans un tout autre genre, un témoignage, celui de Barbara Samson, On n’est pas sérieux quand on a 17 ans. Le récit d’une écervelée inconsciente qui se victimise à souhait. Un livre qui a cependant beaucoup ému et semble continuer aujourd’hui. Enfin, un livre que j’ai aimé mais dans lequel le sida me semble très en retrait par rapport à l’histoire d’amitié qui constitue le fil conducteur de l’histoire, Kyoko, de Ryû Murakami.
En définitive, le sida en littérature est souvent un prétexte à l’écriture. Les autobiographies ont souvent tendance à se pencher sur l’aspect médical, ce qui leur donne un aspect informatif. Mais ce sont aussi dans ces textes personnels qui offrent des approches de la maladie souvent surprenantes. On imagine la détresse que doit être l’annonce d’une mort certaine et pourtant, beaucoup de ces auteurs transforment la maladie en « chance ». Elle permet de découvrir des horizons nouveaux, de se dépasser tant qu’il est encore temps. L’écriture devient un exutoire. Etonnamment, ce qui ressort de cette proximité de la mort, c’est avant tout la fureur de vivre.
Bien sûr cette liste n’est pas exhaustive, je suis loin d’avoir tout lu sur le sujet. Des ouvrages critiques sont également parus sur cette littérature un peu particulière. Le cinéma c’est aussi penché sur le sujet. Je suis plus ignorante encore sur la question. Toutefois, je peux vous signaler le documentaire d’Hervé Guibert, La pudeur ou l’impudeur. Un film extrêmement poignant. Les images sont souvent insoutenables. A ne regarder que si vous n’êtes vraiment pas impressionnable. Côté fiction, le plus connu est Les nuits fauves de de Cyril Collard, que je n’ai malheureusement toujours pas vu. Je pense que le seul film que j’ai sur le sujet est Les témoins d’André Téchiné que j’avais plutôt aimé. J’y avais trouvé quelques longueurs me semble-t-il mais c’est un film qui m’a tout de même marquée.
Le mois prochain, c’est promis, je choisirai un sujet plus porteur. En attendant, j’espère que vous partirez à la découverte de quelques uns de ces auteurs qui ont illuminé mon année.
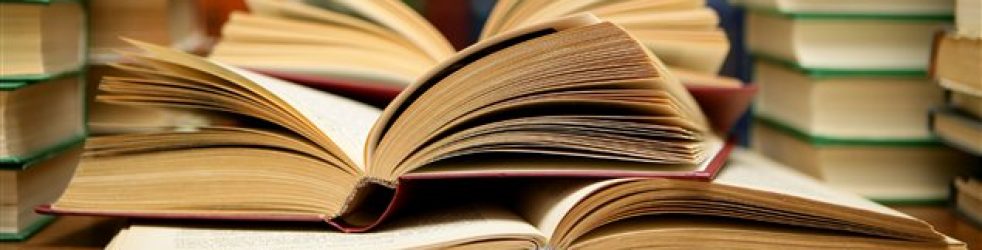
Excellent billet et très bonne idée de mettre en place ces thématiques. Je ne me suis jamais retrouvé à lire un livre traitant du sida et je viens seulement de m’en apercevoir ! D’une manière générale je dois fuir les livres sur les maladies, mais tu m’as donné envie d’en découvrir et de lire sans avoir peur de ressortir de la lecture complètement déprimée !
A part le Murakami que j’avais lu par hasard, je fuyais aussi les livres sur la maladie avant de travailler dessus. C’a été une immense surprise de découvrir que ce n’était pas nécessairement déprimant. C’est sûr que dans la plupart il y a un côté un peu triste, forcément, mais dans l’ensemble c’est surtout un regard sur la vie singulier, teinté d’ironie et très émouvant.
San-Antonio lui-même avait approché le thème en 1987 déjà, avec « Circulez, y’a rien à voir »… A noter que j’ai « Sang maudit » quelque part sur ma pile à lire, me semble-t-il. Merci pour cette piqûre de rappel!
Je note pour le San Antonio, ça m’intrigue. Merci pour l’info 🙂
A reblogué ceci sur Madimado's Bloget a ajouté:
Il y a 6 ans (déjà !) j’écrivais un mémoire sur la littérature et le sida et j’en profitais pour écrire un article sur le sujet. J’ai fait de nouvelles découvertes depuis, lu et vu de nouvelles choses mais cet article – même incomplet – me tient toujours autant à cœur.